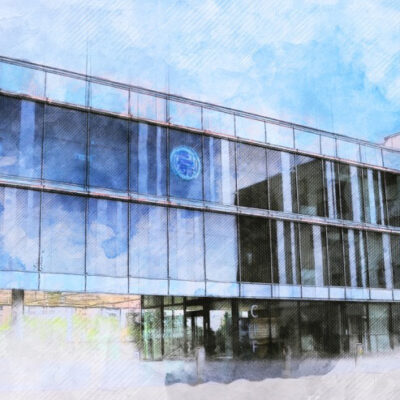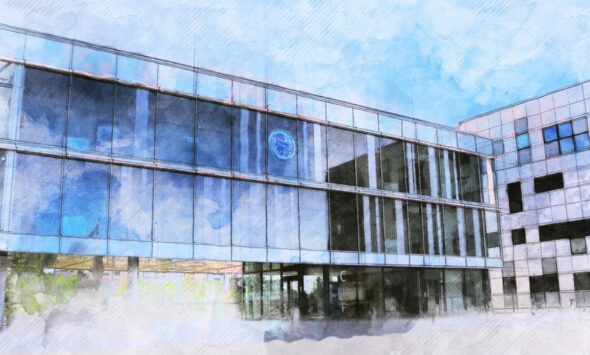Initialement exploité en archéologie, le tartre dentaire révèle aujourd’hui son potentiel en médecine légale. Il conserve des traces de substances ingérées, ouvrant la voie à une analyse post-mortem des consommations médicamenteuses ou de substances psychoactives.
Le tartre dentaire : une matrice négligée, mais précieuse
Le tartre dentaire se forme par la minéralisation progressive de la plaque dentaire, un biofilm composé de salive, de micro-organismes et de résidus alimentaires. Ce processus piège divers composés présents dans la cavité buccale, y compris des xénobiotiques tels que les drogues ou leurs métabolites. Sa composition cristalline confère à cette matrice une excellente conservation des substances qu’elle renferme, tout en la rendant résistante aux dégradations extérieures, y compris dans des contextes post-mortem ou archéologiques.
Une nouvelle voie pour traquer les substances illicites
Récemment, une équipe de chercheurs a démontré la faisabilité d’une approche toxicologique fondée sur l’analyse du tartre dentaire, en utilisant des techniques de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse (LC-MS/MS). Dans une étude portant sur dix cas médico-légaux, les chercheurs ont détecté 131 substances dans le tartre, contre 117 dans le sang, révélant parfois des concentrations plus élevées dans le tartre. La méthode a permis d’identifier des drogues d’usage courant comme la cocaïne, l’héroïne ou les cannabinoïdes, y compris dans des cas où elles n’étaient plus détectables dans les matrices conventionnelles (Sørensen et al., 2021). Ces substances, parfois absentes du sang, étaient présentes en concentrations plus élevées dans le tartre.
Un témoin durable et discret
Cette approche présente plusieurs avantages notables. Elle permet la détection de consommations plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après l’ingestion. Le prélèvement de tartre est non invasif et applicable à des restes squelettiques, ce qui en fait une solution pertinente en archéologie et en anthropologie médico-légale. Elle pourrait ainsi contribuer à éclairer les habitudes de consommation, les traitements médicamenteux ou les causes de décès dans des contextes où le sang, l’urine ou les cheveux sont absents.
Une méthode prometteuse à développer
L’un des atouts majeurs de cette technique réside dans sa capacité à exploiter une matrice souvent négligée, mais fréquemment présente sur les dents. Quelques milligrammes suffisent pour réaliser une analyse fiable, à condition que les substances piégées aient conservé leur stabilité dans le temps. La méthode offre également la perspective d’élargir la gamme de substances identifiables, sous réserve de validations complémentaires.
Bien que prometteuse, cette voie nécessite encore des recherches supplémentaires pour standardiser les protocoles, évaluer la stabilité à long terme des molécules, et intégrer pleinement cette approche dans les pratiques médico-légales courantes. L’approche, encore en phase exploratoire, offre néanmoins un potentiel remarquable dans l’exploitation des matrices alternatives, et ouvre des perspectives inédites pour la toxicologie forensique.
Références :
- Sørensen LK, Hasselstrøm JB, Larsen LS, et al. Entrapment of drugs in dental calculus: detection validation based on test results from post-mortem investigations. Forensic Sci Int 2021; 319: 110647.
- Reymond C, Le Masle A, Colas C, et al. A rational strategy based on experimental designs to optimize parameters of a liquid chromatography-mass spectrometry analysis of complex matrices. Talanta 2019; 205: 120063.
- Radini A, Nikita E, Buckley S, Copeland L, Hardy K. Beyond food: The multiple pathways for inclusion of materials into ancient dental calculus. Am J Phys Anthropol 2017; 162: 71–83.
- Henry AG, Piperno DR. Using plant microfossils from dental calculus to recover human diet: a case study from Tell al-Raqā’i, Syria. J Archaeol Sci 2008; 35: 1943–1950.
Tous droits réservés - © 2026 Forenseek